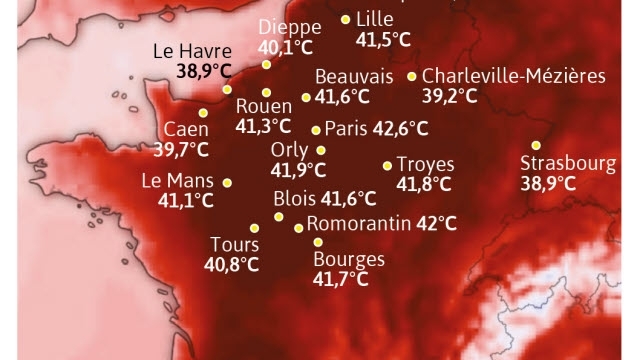A l’heure où le Canada subit un épisode de chaleur extrême, le Conseil d’Etat a rendu une décision inédite en matière de justice climatique (CE, 1er juillet 2021, n°427301, affaire dite de Grande-Synthe). La Haute juridiction administrative a jugé que les mesures prises par l’Etat français étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques européens et internationaux. Par conséquent, la juridiction a ordonné à l’Etat de « prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre » dans un délai de 9 mois.
La lutte contre le changement climatique n’est donc pas seulement une obligation de moyen mais presque de résultat. Si l’État n’est pas à la hauteur des enjeux, le recours au juge permet de l’obliger à agir dans l’intérêt commun via des politiques publiques efficaces.
Contexte
Dès 2018, la commune littorale de Grande Synthe, exposée aux effets du changement climatique, et plusieurs associations, ont demandé à l’Etat de mettre en place des mesures supplémentaires afin de respecter la trajectoire climatique dessinée par l’Accord de Paris. Par une décision de novembre 2020, le Conseil d’État a demandé à l’Etat, dans un délai de trois mois, de justifier que son refus de prendre de telles mesures était compatible avec les objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’il s’est fixé volontairement (l’objectif initial de 37 % par rapport à 2005 d’ici à 2030 fixé par l’Union européenne ayant été rehaussé par la France à 40% de réduction en 2030 par rapport à 1990).
Analyse
Par cette seconde décision du 1er juillet 2021, le Conseil d’État condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français.
Le Conseil d’Etat juge notamment que la réduction d’émissions de GES en 2019 reste limitée et que celle de 2020 est due à la crise sanitaire qui a « conduit à une forte réduction du niveau d’activité et, par voie de conséquence, du niveau des émissions de gaz à effet de serre ». De plus, le Conseil prend en compte l’avis du Haut conseil pour le climat (HCC) sur le projet de loi « Climat et résilience », les rapports du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui convergent tous pour conclure à l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour respecter les objectifs fixés.
Le Conseil ajoute que les objectifs climatiques ont été relevés par l’Union européenne à 55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Le Conseil note enfin que le projet de loi « Climat et résilience », d’ailleurs remanié par le Sénat cette semaine, ne pourrait pas permettre d’atteindre l’objectif ainsi assigné.
Par conséquent, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre n’ont pas été prises par l’État français, de sorte qu’il doit y remédier dans un délai de 9 mois. Il est à noter que ce délai prendra fin à l’approche de l’élection présidentielle.
Cette décision très attendue s’inscrit dans un mouvement d’ébullition de la justice climatique, tant nationale, qu’internationale. Il faut en effet rappeler le jugement dit de « l’affaire du siècle », dans lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu l’Etat responsable du préjudice écologique né de son inaction climatique. Le tribunal judiciaire de Nanterre a également jugé que le plan de vigilance climatique et social de Total, dépassait le strict cadre de la gestion de la société commerciale, touchait la société en son ensemble et relevait en l’occurrence de la responsabilité sociale de l’entreprise.
Au niveau européen, la Cour suprême de La Haye dans l’affaire « Urgenda » a considéré que l’État néerlandais avait l’obligation d’atteindre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici la fin de 2020 par rapport aux niveaux de 1990 » (La Haye Supreme Court, 20 décembre 2019, n°19/00135). Plus récemment, le tribunal de La Haye a condamné la société Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010.
Ainsi, la justice climatique est de plus en plus contraignante autant vis-à-vis des États que des acteurs privés, notamment les entreprises. Nous pouvons donc nous demander si, à l’instar des Pays-Bas, cette décision Grande-Synthe condamnant l’Etat français, ne préfigure pas la mise en cause d’entreprises françaises pour inaction climatique.
Carl Enckell et Chloé Le Juez – Enckell Avocats