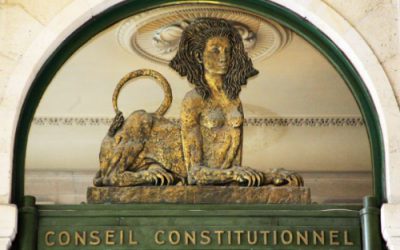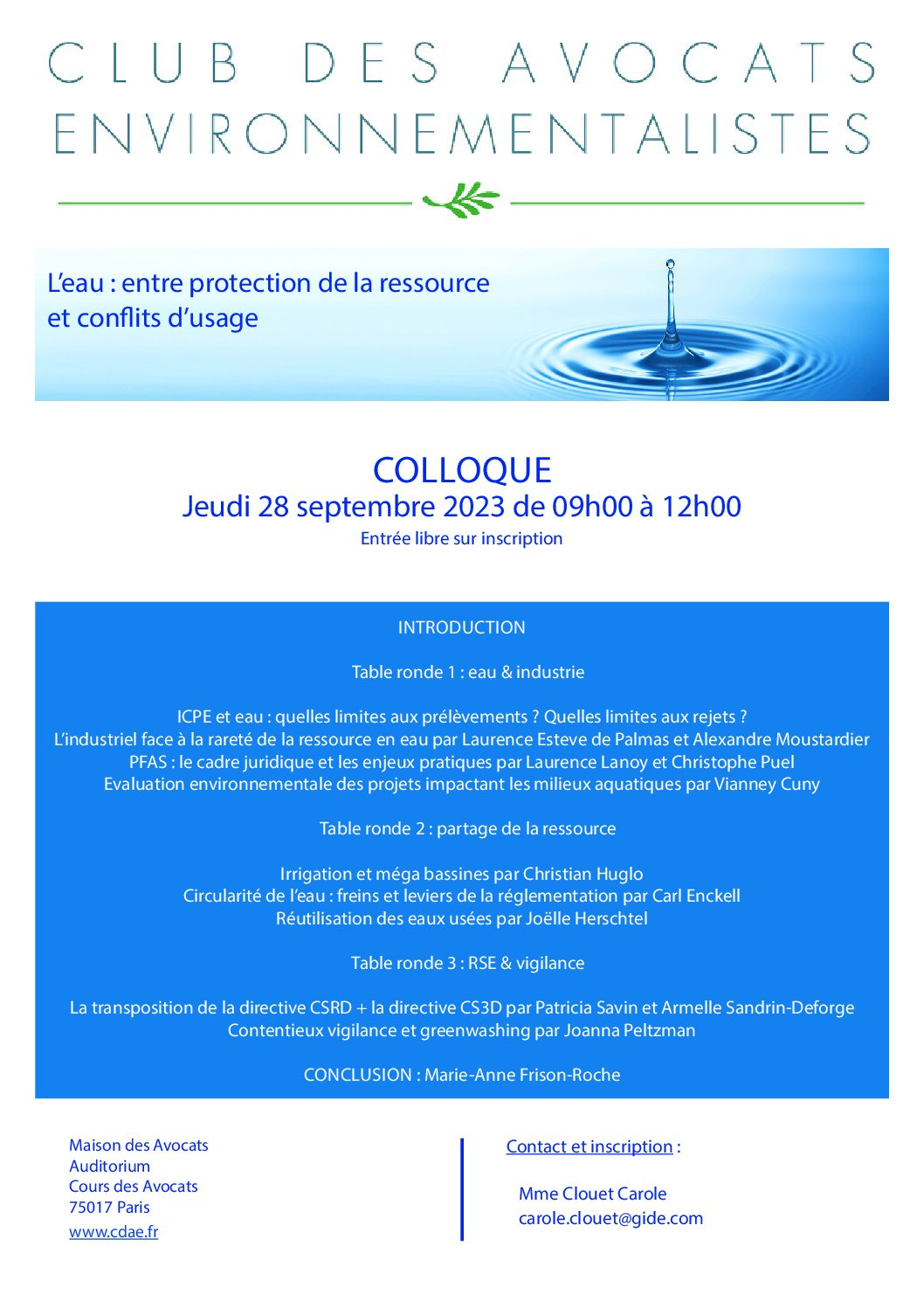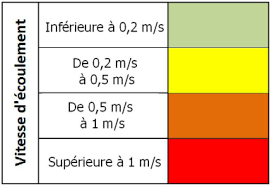Suite à un recours de la Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le Conseil Constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de l’obligation faite aux exploitants d’établissement de stockage d’accepter prioritairement les déchets résiduels issus du réemploi, du recyclage et de la valorisation.
Par une décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022, il a jugé que cette disposition de la loi AGEC portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
I. Contexte
L’élimination des déchets (enfouissement dans les centres de stockage), est le dernier échelon de la hiérarchie des modes de traitement. La règlementation européenne (Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives), reprise en droit national à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement (C. env), impose ainsi un ordre de priorité de mode de gestion des déchets : 1°) Prévention et réduction des déchets ; 2°) Réemploi ; 3°) Recyclage ; 4°) Valorisation ; 5°) Elimination.
Les déchets faisant l’objet d’une élimination sont composés à la fois des déchets dit ultimes, destinés directement à l’élimination et des déchets dit résiduels, issus des différents modes de traitements privilégiés (réemploi, recyclage et valorisation : par ex. refus de tri, mâchefers non-valorisables…).
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a pour objet d’améliorer la gestion des ressources et des déchets, notamment en mettant l’accent sur la réparation et le réemploi des produits, ainsi que sur le recyclage des matériaux.
Elle a créé l’article L. 541-30-2 du C. env qui accorde une priorité d’accès aux centres de stockage des déchets, pour les déchets résiduels. La loi ajoute que l’exploitant du site d’enfouissement n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés (Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, n° 3386 , déposé le mercredi 30 septembre 2020). Enfin, l’article interdit toute indemnisation de l’exploitant de l’installation de stockage et de ses cocontractants.
C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion d’un recours en annulation du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 d’application de l’article L. 541-30-1 du C. env, la FNADE a déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article.
En effet, si ce dispositif contribue au développement de l’économie-circulaire, il conduit à remettre en cause les contrats par ailleurs conclus par les exploitants de centre d’enfouissement de déchets avec d’autres partenaires, privant ces derniers des garanties de traitement de leurs déchets.
Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? C’est ce qu’ont jugé les sages du Conseil Constitutionnel.
II. Une atteinte manifeste au droit au maintien des conventions légalement conclues
2.1. Dans le cadre du recours contre le décret d’application de la loi, le rapporteur public Olivier Fuchs a proposé à la formation de jugement de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel. La liberté d’entreprendre est composée de deux volets : liberté dans la conclusion des contrats et droit au maintien des conventions légalement conclues. Or, selon Olivier Fuchs, l’article L. 541-30-2 portait atteinte à la liberté contractuelle en ce qu’il peut avoir pour effet, d’une part, d’obliger les installations de stockage d’entretenir des relations contractuelles non désirées, et d’autre part, d’empêcher de respecter des engagements contractuels préalables. De plus, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre entretenant des liens étroits, il y avait selon lui lieu d’admettre que la question de l’atteinte à la liberté d’entreprendre était sérieuse.
Par une décision de renvoi n° 448305 du 3 décembre 2021, les juges ont suivi le sens des conclusions du rapporteur public. La décision de renvoi du Conseil d’Etat est concise et se contente de relever que « le moyen tiré de ce que l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement méconnaît la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre présente un caractère sérieux ».
2.2. Dans sa décision n° 2021-968 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 541-30-2 du C. env portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues en ce qu’au vu de la saturation des installations de stockage, il est « susceptible de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets ».
Mais il souligne que cette atteinte étant motivée par la poursuite de « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement », elle pourrait être justifiée si elle n’était pas disproportionnée.
Tel n’est pas le cas ici, le Conseil relevant les raisons pour lesquelles l’atteinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi:
1.. la loi impose la reprise des déchets mêmes quand il n’y a pas de difficulté de traitement de ces déchets ;
2. l’obligation de prévenir au moins 6 mois avant la réception des déchets ne permet pas de prévenir l’impact sur les autres contrats de l’exploitant des installations de stockage ;
3. toute indemnisation étant interdite, les autres partenaires de l’exploitant de l’installation ne pourront pas obtenir réparation si leur contrat ne peut pas être exécuté.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conçues.
L’article L. 541-30-2 du Code de l’environnement étant jugé inconstitutionnel il n’est plus applicable à compter de la date de publication de la décision, c’est-à-dire du 12 février 2022. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur le recours contre le décret d’application, mais sa censure est certaine.
III. Une autre solution ? la réquisition
L’objectif vertueux de garantir le stockage des déchets résiduels (réemploi, recyclage valorisation) peut être atteint d’une autre façon : en mettant en œuvre le droit de réquisition préfectorale entré depuis plus de 20 ans dans la loi.
La loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un 4° à l’article L. 2215-1 du Code des collectivités territoriales (CGCT) donnant, en cas d’urgence, le pouvoir au préfet du département de réquisitionner tout bien ou service nécessaire à faire cesser une atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.
L’article prévoit une rétribution afin de compenser les frais matériels, directs et certains, résultant de la réquisition. Plus précisément, l’article dispose :
« Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. »
C’est en substance ce que prévoit de façon systématique l’article L. 540-30-2 du C. env quand il estime que le prix de la reprise des déchets doit être le même que celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.
Or, par une décision du n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 le Conseil constitutionnel a jugé que la réquisition telle que prévue à l’article L. 2215-1 du CGCT était constitutionnelle dans la mesure où elle est suscitée par un besoin.
Ainsi, une obligation de reprise des déchets issus de traitement privilégiés serait constitutionnelle si elle était limitée au ou aux secteurs dans lesquels il y a une difficulté de traitement de ces déchets résiduels.
Malgré la décision du Conseil constitutionnel, cette obligation peut donc toujours être mise en place sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGCT via un arrêté de réquisition dans les départements où les filières de traitement des déchets ont des difficultés pour procéder à leur traitement.