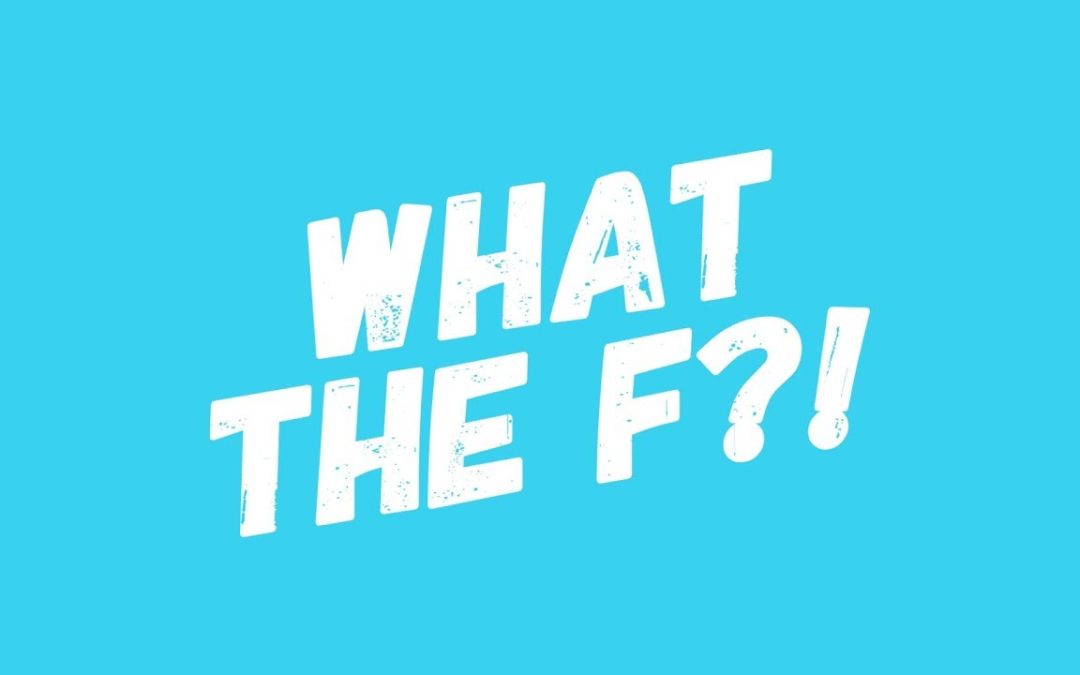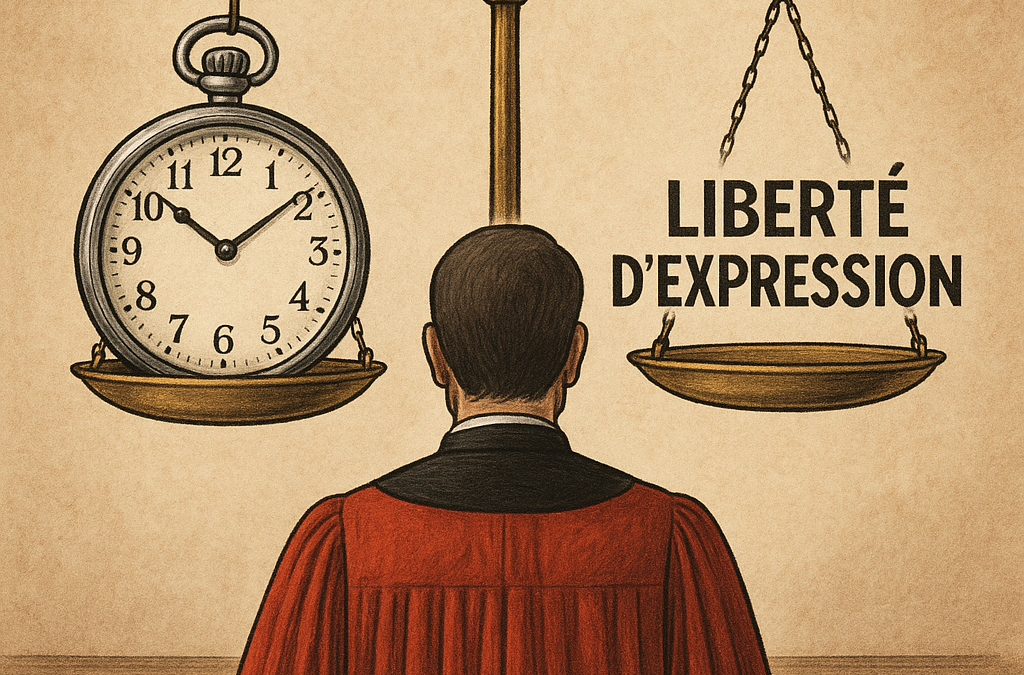Dans un arrêt du 16 novembre 2011 qui fera date, sans aucun doute, le Conseil d’Etat vient de valider l’intégralité des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques (CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre et autres, req. n 344972 et suivantes).
Dans un arrêt du 16 novembre 2011 qui fera date, sans aucun doute, le Conseil d’Etat vient de valider l’intégralité des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques (CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre et autres, req. n 344972 et suivantes).
Pour confirmer le caractère rétroactif du décret (sur la date d’entrée en vigueur du moratoire, fixée au 2 décembre 2010, soit 8 jours avant sa publication au Journal Officiel), le Conseil d’État procède a un revirement de jurisprudence.
Décryptage d’un arrêt qui fait émerger une nouvelle exception au principe de non rétroactivité des actes administratifs : le requérant devrait se trouver dans une « situation juridiquement constituée ».
1 Consultations préalables
Le Conseil d’État juge tout d’abord que le Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) a pu se réunir régulièrement le 9 décembre 2010 pour rendre un avis sur le projet de décret. Bien que le décret ait été signé le même jour que la réunion du Conseil Supérieur de l’Energie ce délai « a été suffisant pour permettre au Gouvernement de procéder, au vu de cet avis, à l’examen des modifications suggérées, les dispositions adoptées tenant ainsi compte, sur plusieurs points, des observations formulées par cet avis ».
Par ailleurs, aucune disposition n’obligeait de consulter la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), préalablement à la signature du décret. Un doute subsiste dès lors que le texte instaurant le moratoire disqualifie également tous les opérateurs concernés de la file d’attente avant raccordement, ce qui relève de la compétence de la CRE.
2 Information et participation du public
Eu égard à la nature et à la durée « très limitée » de la suspension prononcée, le Conseil d’Etat juge que le Gouvernement a pu se passer d’une consultation du public sans méconnaitre la charge de l’environnement, et notamment son article 7.
3 Article 10 de la loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité
Le Premier Ministre a légalement pu estimer que l’obligation de conclure un contrat d’achat ne répondait plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements au vu de la capacité des installations mises en service mais également de celle des installations ayant fait l’objet d’une demande de raccordement. Le Conseil d’État reprend à son compte les informations selon lesquelles les demandes en attente étaient estimées à 5.375 mégawatts en novembre 2010, « dont le Gouvernement était fondé à considérer que la moitié au moins serait effectivement mise en service dans les mois à venir ».
4 Droit de l’Union Européenne et principe de confiance légitime
Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union Européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées.
Toutefois, il précise, aussitôt, qu’un opérateur économique, « prudent et avisé », qui serait en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée. Or, aucune disposition du droit de l’Union Européenne n’imposait de maintenir un tarif d’achat inchangé.
En d’autres termes, les opérateurs privés ne peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime dès lors qu’ils connaissaient le projet du Gouvernement de mettre fin aux conditions tarifaires du rachat de l’énergie d’origine photovoltaïque. En outre :
– la loi du 12 juillet 2010 (loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II ») a précisé que les contrats régis par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclus, et n’engagent les parties, « qu’à compter de leur signature ».
– plusieurs rapports ont souligné le développement trop rapide des installations de production d’énergie solaire et le niveau excessif du tarif d’achat pesant sur les consommateurs (avis de la CREE, rapport du Conseil Général de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies et rapport de l’Inspection Générale des Finances).
Dans ces conditions, les opérateurs « prudents et avisés » pouvaient prévoir la suspension provisoire de l’obligation d’achat et la remise en cause des tarifs applicables quand bien même les arrêtés ministériels fixant les conditions d’achat de du solaire prévoyaient que le tarif applicable dépende de la date d’acceptation de la PTF.
En d’autres termes, si des opérateurs se sont retrouvés pris de court, avec des conséquences financières parfois désastreuses, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes dès lors que l’ensemble des informations disponibles aurait dû les inciter à ne pas poursuivre leurs opérations, malgré la sécurité juridique offerte par les arrêtés tarifaires ministériels.
Selon nous, ce raisonnement est, au minimum, inapplicable à ceux des opérateurs qui ont adressé leur PTF entre la date du 2 décembre et celle du 10 décembre 2010 (c’est-à-dire avant la publication au Journal Officiel du décret), mais nous examinerons ce point plus précisément ci-après.
En outre, en l’espèce, ce sont les atermoiements des pouvoirs publics s’agissant de la baisse du tarif de rachat du solaire (notamment les déclarations successives du Ministère de l’Environnement à partir du mois de septembre 2010) qui ont directement conduit à la bulle spéculative et à l’engorgement des demandes.
5 Droit au respect des biens (protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme)
Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord que l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent, fondée sur une base juridique suffisante, doit être regardée comme un bien, même en l’absence de créance certaine. Cependant, il relève aussitôt que la modification instaurée par la loi « engagement national pour l’environnement » du 12 juillet 2010, a eu pour effet de préciser que les parties ne sont engagées qu’à compter de la signature du contrat d’achat, de sorte que les opérateurs du solaire ne peuvent se prévaloir « d’une espérance légitime à la conclusion d’un contrat à des conditions tarifaires inchangées ».
Là encore, le Conseil d’Etat s’en remet au principe rappelé par la loi Grenelle II selon laquelle un contrat n’est formé qu’à compter de sa signature entre les parties. Cependant, selon nous, les requérants n’auraient pas invoqué le principe de « confiance légitime » s’ils avaient signé un contrat d’achat avec EDF. Dans un tel cas, en effet, la créance aurait été certaine et ils se seraient tournés vers le juge du contrat sans devoir invoquer la convention européenne des droits de l’homme.
6 Principe d’égalité
Le Conseil d’État juge que le décret a pu maintenir un tarif préférentiel pour les seules « installations de très faible puissance » (inférieure ou égale à 3 kilowatts) car les inconvénients qu’auraient connus leurs promoteurs auraient été « particulièrement élevés », sans pour autant que cela eut entraîné un effet significatif sur les finances publiques, répercuté sur le consommateur d’électricité. Il ajoute que la date du 2 décembre 2010, retenue par le décret du 9 décembre 2010, « est celle de l’annonce faite par le Gouvernement de la mesure de suspension ». Cette phrase sibylline aurait mérité d’être mieux expliquée, dans la mesure où on comprend mal à quoi elle se rapporte : communiqué de presse, déclaration publique ?
7 Principe de non rétroactivité des actes administratifs
En dernier lieu, le Conseil d’Etat se prononce sur la question juridique la plus débattue : la rétroactivité du décret du 9 décembre 2010 (publiée au JO le 10 décembre) au 2 décembre 2010.
Selon le Conseil d’État, le décret ne méconnait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que les producteurs lésés par la suspension n’étaient pas déjà liés à EDF par un contrat quelconque ou « placé dans une situation juridiquement constituée avant la signature d’un tel contrat ». Une nouvelle fois, mais de manière indirecte, le Conseil d’État fait référence à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et à ses dispositions selon lesquelles les contrats régis par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 ne sont conclu, et n’engagent les parties, qu’à compter de leur signature.
Cette motivation semble résulter d’un revirement de jurisprudence. En effet, le principe de la jurisprudence administrative est que la rétroactivité des règlements est interdite (CE, 25 juillet 1948, société du journal l’Aurore). Par exception à ce principe, le Conseil d’État a prudemment toléré une rétroactivité des actes réglementaires dans un nombre de cas limités, énumérés sur le propre site internet du Conseil d’Etat:
– si cela résulte d’une loi (pas le cas en l’espèce puisque c’est un décret qui est en cause)
– si l’effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir (arrêt Rodière).
– si l’Administration procède au retrait d’un acte illégal (arrêt Dame Cachet).
– si la rétroactivité de l’acte est exigée par la situation qu’il a pour objet de régir.
– si un premier règlement prévoit que les règlements pris pour son application s’appliqueront le jour de sa propre entrée en vigueur.
En l’espèce, la rétroactivité prévue par le décret du 9 décembre 2009 ne satisfaisait à aucune de ces exceptions. Il faut donc considérer que le Conseil d’Etat procédé à un revirement de jurisprudence : Un règlement peut désormais s’appliquer rétroactivement à des administrés qui ne se trouveraient pas dans une « situation juridiquement constituée ».
Cette nouvelle exception est a première vue baroque puisqu’elle revient, en quelque sorte, a apprécier la légalité d’un acte règlementaire rétroactif en considération de la qualité du requérant (celui-ci se trouve-t-il dans une « situation juridiquement constituée » ?)
Le raisonnement laisse également penser que le Conseil d’État a tranché une question de légalité d’un acte administratif (en qualité de juge de l’excès de pouvoir) en raisonnant comme juge du contrat, ce qui est inédit. Faut-il en déduire qu’il a involontairement anticipé sur d’éventuelles actions indemnitaires ?
Enfin, cette exigence de justification d’une « situation juridiquement constituée » s’imposera-t-elle à l’avenir à tout administré contestant le caractère rétroactif d’un règlement ?
___________________________________________________________________________________
En définitive, cet arrêt, décevant quant à la motivation de l’exception au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, témoigne de la très mauvaise qualité du mécanisme juridique mis en œuvre pour favoriser l’émergence des énergies renouvelables, et notamment du photovoltaïque.
En effet, la règle du rachat obligatoire de l’énergie par l’opérateur historique crée un déséquilibre dans les relations contractuelles qu’il implique. Il en irait autrement si l’électricité produite était vendue directement sur le réseau sans rachat obligatoire par EDF avec le bénéfice d’une subvention publique au producteur, de manière à lui permettre d’équilibrer son activité. Cela supposerait cependant que les producteurs indépendants puissent participer eux-mêmes au mécanisme d’ajustement directement ou indirectement.
Cette situation pourrait n’être que provisoire si, comme les projections professionnelles de la filière l’indiquent, l’énergie photovoltaïque sera rentable sans subvention d’ici l’horizon 2016.