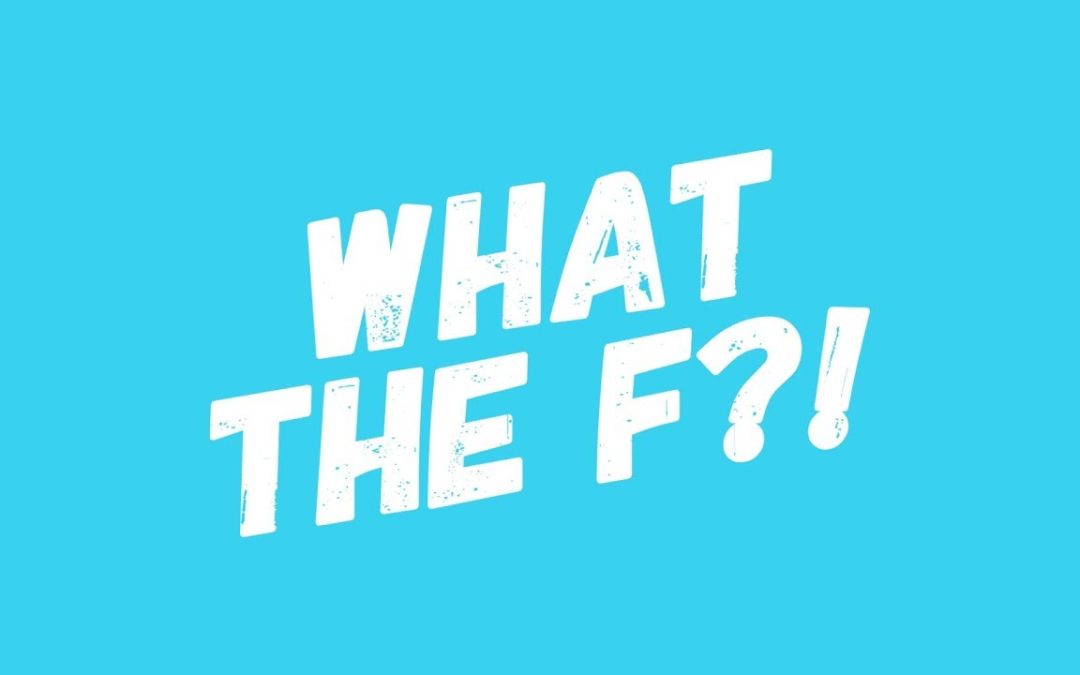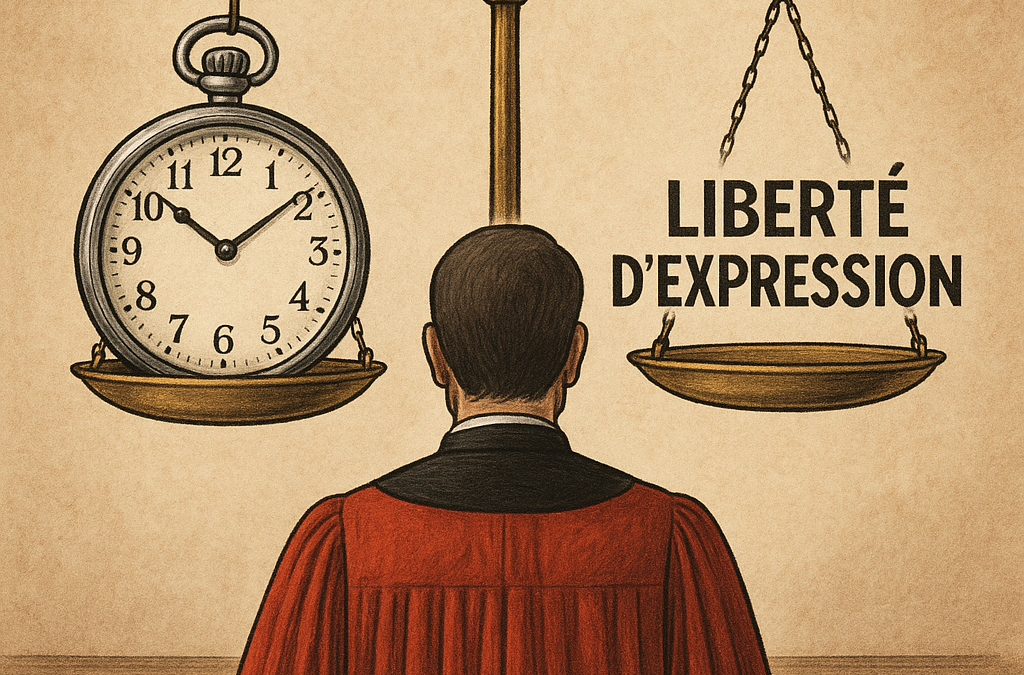L’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir.
L’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir.
Le Conseil d‘état vient de trancher, en dernier ressort, la légalité du permis de construire du parc éolien de Névian. Il déclare illégale 3 des 21 éoliennes du parc au motif que les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété ont été méconnues (CE, 9 décembre 2011, req. n° 341.274).
Décryptage.
Dans le dossier du parc éolien de Névian, on se souvient que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a fait frémir la profession en ordonnant la démolition de 4 des 21 éoliennes, sans que le permis de construire ait été annulé au préalable, et en accordant un dédommagement important (500.000 €) à un riverain, au titre du trouble anormal de voisinage. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et la décision de la Cour est très attendue.
Dans la présente affaire, c’est le permis de construire qui vient d’être déclaré partiellement illégal. Le Conseil d’état juge que les éoliennes sont des constructions soumises aux règles de distances par rapport aux limites de propriété inscrites dans le document d’urbanisme La Haute Assemblée en déduit que les trois éoliennes 19, 20, et 21 du parc ne respectent pas l’article NC7 du POS de la Commune de NEVIAN (CE, 9 décembre 2011, req. n° 341.274).
Le Tribunal Administratif de Montpellier, comme la Cour Administrative d’Appel de Marseille, avaient pourtant rejeté la requête dans son intégralité.
1. Limites séparatives
a. La question de savoir si les parcs éoliens (ou les centrales photovoltaïques au sol) sont des « bâtiments » ou encore des « constructions », soumis, à ce titre, à toutes les règles d’urbanisme des POS ou des PLU, est fréquemment posée.
Aucun texte de loi ou règlement n’apporte de réponse et il convient de se reporter à la jurisprudence administrative. Les différentes décisions rendues montrent que le juge se prononce quasi systématiquement non pas en fonction de considérations générales, mais au cas par cas, selon les termes précis retenus et la volonté des auteurs du document d’urbanisme dans le POS ou le PLU. On peut donc parler d’arrêts d’espèce et non d’arrêt de principe.
La récente décision du Conseil d’Etat du 9 décembre 2011 confirme cette pratique jurisprudentielle, puisque le Conseil d’Etat tranche la question de la légalité du permis de construire après avoir apprécié ce que les auteurs du document d’urbanisme ont voulu lui faire dire. Ce n’est pas toujours une chose facile.
b. Le permis de construire du parc éolien de Névian a été déposé sur un secteur du POS classé « NCe », à vocation d’énergie éolienne (jusque là, tout va bien) distinct de la zone naturelle NC à vocation agricole.
Mais la particularité du dossier est que le règlement de zone du POS comporte une contradiction intrinsèque en maintenant sur le secteur NCe l’application des articles relatifs à la hauteur maximum des constructions (NC 10) et aux distances par rapport aux limites séparatives de propriété (NC7).
Ces articles constituent de réels obstacles aux parcs éoliens, puisqu’ils limitent la hauteur et la distance. C’est le cas en l’espèce : la hauteur est limitée à 8,50 m et la distance par rapport à la limite de propriété est la moitié de la hauteur de la construction (cad 75 m pour une éolienne de 150 m).
Dès l’origine, il semble qu’il ait été maintenu dans le règlement d’urbanisme cette contradiction évidente entre la vocation du secteur (parc éolien) et ces règles. Mais le permis a été conçu déposé et délivré en l’état. En première instance et en appel, les juges (Tribunal Administratif de Montpellier et Cour Administrative d’Appel de Marseille) se sont montrés magnanimes et ont écarté les deux règles gênantes, en estimant que la volonté des élus avait été avant toute chose de favoriser les parcs éoliens. Le permis a donc été confirmé dans son intégralité.
En cassation, le Conseil d’état est obligé de procéder à un contrôle du même type, tenant à déterminé quelle a pu être la volonté des élus :
S’agissant de la règle de hauteur, la première analyse est confirmée au motif que les auteurs du PLU ont « nécessairement entendu faire échapper ce secteur aux règles générales de la zone NC manifestement incompatibles avec l’implantation des éoliennes, comme celle de l’article NC10 limitant la hauteur des constructeurs à 8,5 mètres ».
On peut s’arrêter un instant sur cette première considération. La limite de hauteur étant fixée à 8,50, le Conseil d’état juge qu’elle est totalement inapplicable puisque les éoliennes sont bien plus grandes. Cet article est donc inapplicable au secteur NCe. Comme les premiers juge, le Conseil d’état s’autorise à corriger, de la sorte, un oubli (sic) des élus.
S’agissant de la règle de distance par rapport aux limites séparatives (article NC7), le Conseil d’État ne s’autorise pas à adopter le même raisonnement.
En l’espèce, l’article NC 7 du POS de Névian, applicable au secteur NCe, dispose, comme c’est généralement le cas, que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.
En pratique, bien que cette règle conduise à imposer un prospect de 75 mètres pour des éoliennes d’une hauteur de 150 mètres, la règle de distance par rapport aux limites de propriété n’est pas inapplicable. Elle limite très fortement les possibilités d’implantation, puisqu’elle les réserves à de très grandes propriétés, mais n’empêche pas dans tous les cas l’opération.
A ce titre, contrairement aux dispositions de l’article NC10 relatives à la hauteur, le Conseil d’Etat juge que les dispositions ne sont pas « manifestement incompatibles avec l’implantation des éoliennes », de sorte qu’il ne s’autorise pas à juger que les élus ont entendu faire échapper l’article NC7 au secteur NCe.
c. Analyse
Cette décision devrait inciter les opérateurs, comme les collectivités publiques et les services de l’Etat chargés de l’instruction des demandes, à la plus extrême vigilance s’agissant de la conformité des projets de pacs éoliens avec les règles d’urbanisme.
Un audit préalable du dossier de permis de construire, impliquant nécessairement celui du règlement d’urbanisme, devrait permettre d’éviter de telles situations. En l’espèce, il aurait fallu toiletter le règlement en prenant soin de déclarer inapplicables, lors de la rédaction du POS, les articles NC 7 et NC 10 au secteur NCe.
d. Arrêt d’espèce
Il ne faut cependant pas considérer que cet arrêt a valeur de principe puisque, dans d’autres cas, le juge administratif devrait toujours pouvoir écarter les règles du document d’urbanisme, notamment si elles sont rédigées de manière plus étroite.
Tel serait le cas d’un article 7 (distance par rapport aux limites séparatives de propriété) qui viserait exclusivement les « bâtiments » (et pas les constructions) ou qui ne serait défini que selon la différence de hauteur entre le terrain naturel et l’égout de toiture. Dans ce dernier cas, le juge administratif estime que les auteurs du document d’urbanisme ont manifestement entendu réserver l’application de ces règles à des bâtiments tels que des maisons d’habitation, mais non à des ouvrages techniques tels que des éoliennes (qui ne sont pas dotées d’égout de toiture) (décision du cabinet déjà commentée sur ce blog : TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, Association X, req. n° 1001088,1001081 et 1001082).
2 – étude d’impact
L’étude d’impact volontairement produite par la Compagnie du Vent n’est pas jugée insuffisante, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne la prévoyait à la date de délivrance du permis. En effet, le Conseil d’État juge que le pétitionnaire ayant réalisé une étude d’impact « de sa propre initiative » à une date à laquelle l’octroi du permis ne dépendait pas obligatoirement de la réalisation d’un tel document, n’a pas l’obligation de respecter toutes les prescriptions applicables aux études d’impact.
Une étude d’impact ad’hoc réalisée spontanément par le pétitionnaire n’a donc pas à respecter les formalités légales et réglementaires.
3. Zonage NC
Un règlement d’urbanisme peut justifier un classement en zone naturelle par l’exposition aux vents. Le Conseil d’État juge que la Commune a pu, à juste titre, classer une partie de son territoire en zone de richesses naturelles, dite zone NC. D’après l’article R.123-18 du Code de l’Urbanisme, alors applicable, les zones NC sont des territoires à protéger en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol et du sous-sol.
Les requérants avaient contesté l’opportunité d’un tel classement en estimant que l’exposition aux vents ne pouvait suffire à le justifier. Le Conseil d’État confirme la décision de la Commune de Névian sur ce point en jugeant que celle-ci pouvait parfaitement retenir le seul critère de l’exposition aux vents pour justifier un tel classement.