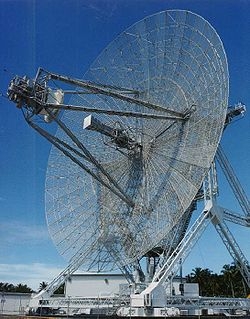 Le nouveau cadre réglementaire de l’éolien terrestre a été défini au cours de l’été 2011. Censé garantir une procédure « sûre » et « rapide » pour les exploitants, d’une part, et l’acceptation de ces projets par les populations locales, d’autre part, ce nouveau régime juridique impose aux opérateurs d’obtenir un acte administratif supplémentaire : l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le nouveau cadre réglementaire de l’éolien terrestre a été défini au cours de l’été 2011. Censé garantir une procédure « sûre » et « rapide » pour les exploitants, d’une part, et l’acceptation de ces projets par les populations locales, d’autre part, ce nouveau régime juridique impose aux opérateurs d’obtenir un acte administratif supplémentaire : l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
C’est désormais législation ICPE qui appréhende la question de l’interaction des éoliennes et des radars. D’après les nouveaux textes, l’octroi de l’autorisation ICPE dépend en réalité non pas d’une mais de deux autorités :
– Une première autorité, sans aucune compétence légale : l’opérateur radar (civil ou militaire), qui dispose d’un pouvoir quasi-absolu pour préinstruire les dossiers d’autorisation ICPE des parcs éoliens.
– Une seconde autorité (la seule autorité légalement compétente) : le Préfet, qui a compétence liée pour faire application de l’avis de l’opérateur radar.
Ce nouveau dispositif juridique, totalement inédit et pour le moins baroque, soulève des interrogations juridiques majeures s’agissant de sa légalité.
i Le nouveau cadre juridique de l’éolien
La question de l’opportunité de soumettre les parcs éoliens à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement a longuement été discutée devant l’Assemblée Nationale puis dans le cadre des organes de représentation de la profession.
Le nouveau cadre réglementaire de l’éolien terrestre a finalement été approuvé par la loi puis défini par le règlement au cours de l’été 2011.
Les textes d’application permettant d’imposer aux parcs éoliens le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont été successivement adoptés par :
– le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées,
– le décret 2011-985 du 23 août 2011 définissant les garanties financières nécessaires à la mise en œuvre d’une installation d’éoliennes,
– un arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières
– un arrêté du 26 août 2011 relatif aux parcs éoliens soumis à autorisation ICPE
– un arrêté du 26 août 2011 relatif à aux parcs éoliens soumis à déclaration ICPE.
Le MEDDTL a par ailleurs diffusé une circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des ICPE.
Sur le plan strictement juridique, on peut distinguer le régime du permis de construire de l’autorisation ICPE de la manière suivante :
– le permis de construire relève de la réglementation de la construction de l’édifice proprement dit ;
– l’autorisation ICPE concerne les modalités d’exploitation de l’équipement et les effets qu’il peut emporter sur son environnement.
L’expérience montre que l’assujettissement des parcs éoliens à la législation des ICPE représentera une contrainte supplémentaire pour les exploitants au même titre que pour tout ouvrage ou équipement soumis à la législation ICPE. En effet, l’application concurrente des législations de l’urbanisme, d’une part (permis de construire) et des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part (autorisation d’exploitation) a pour effet immédiat de soumettre les parcs éoliens à deux catégories d’autorisations administratives distinctes, relevant chacune d’une législation propre (urbanisme dans un cas et installations classées dans l’autre).
Un parc éolien ne pourra donc pas être mis en service sans le bénéfice de chacune de ces deux autorisations administratives. Dès lors, les risques juridiques s’en trouveront accrus pour les exploitants dans la mesure où les risques de blocage des projets vont être multipliés : Deux décisions administratives à obtenir (chacune pouvant éventuellement être attaquée).
ii Interaction éoliennes-radar : le nouveau cadre juridique soulève des questions supplémentaires
La question de l’interaction des éoliennes et des radars est désormais appréhendée par la législation ICPE applicable aux éoliennes.
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux parcs éoliens soumis à autorisation ICPE prévoit, en son article 4, des règles de distance entre les éoliennes et les radars météorologiques, de l’aviation civile et des ports (entre 10 et 30 km). Il s’agit des distances minimales d’éloignement imposées aux exploitants de parcs éoliens, sauf accord écrit de l’autorité compétente pour l’aviation civile, la météorologie ou les ports.
S’agissant des « équipements militaires », l’arrêté ne prévoit aucune distance minimale mais se contente de prescrire que : « les perturbations générées par l’installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires ».
Mais qui est à même de contrôler cette prescription : le préfet et ses services (DREAL) ? Non. L’arrêté ministériel déclare que l’exploitant doit implanter ces aérogénérateurs selon une configuration qui a fait l’objet d’un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente.
Ces dispositions ne manquent pas de soulever des interrogations auxquelles la circulaire du 29 août 2011 a tenté de répondre.
iii De la concertation préalable à l’avis conforme
Le Ministre de l’Environnement précise, dans la circulaire du 29 août 2011, s’agissant des règles de coexistence entre les éoliennes et les radars, que la phase de concertation entre le pétitionnaire et l’opérateur radar se fera avant le dépôt du dossier ICPE.
Ce faisant, le MEDDTL tente de répondre aux nombreuses difficultés soulevées jusqu’à présent par l’appréciation portée par les services de l’État sur la coexistence entre radars entre éoliennes.
Cependant, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, le nouveau cadre juridique ne répond pas aux situations jusqu’à présent opposées par les services de l’État pour refuser un permis de construire : zone d’exclusion mutuelle par exemple en cas de parc éolien préexistant dans le périmètre d’un radar.
En outre, il ne s’agit pas d’une concertation car l’accord explicite de l’opérateur radar sera obligatoire pour tous les radars militaires et pour toute dérogation aux règles de distance des radars civils.
Cette question soulève immédiatement plusieurs interrogations juridiques :
– Comment interpréter le flou juridique dont bénéficient les équipements militaires (pour lesquels l’arrêté du 26 août 2011 ne fixe aucune règle indicative de distance) ?
– Sur quel fondement juridique repose le mécanisme mis en œuvre ? En effet, selon la circulaire du 29 août 2011, le Préfet aura purement et simplement compétence liée s’agissant de l’avis de l’opérateur radar civil, si une dérogation est requise par rapport aux règles de distances.
En pratique, l’opérateur radar (civil ou militaire) disposera d’un pouvoir très large pour préinstruire les dossiers d’autorisation ICPE des parcs éoliens.
Partant du principe nécessaire d’une concertation entre les opérateurs éoliens et les opérateurs radars, le régime juridique mis en place aboutit à un pouvoir de censure à la disposition des opérateurs radars, que le Préfet (représentant de l’État) ne pourra pas contredire.
C’est juridiquement extrêmement discutable dans la mesure où la seule autorité compétente pour octroyer une autorisation ICPE (comme pour un permis de construire) est le Préfet, pour le compte de l’État. Or, en l’état actuel du droit, il n’est pas prévu qu’une autorité puisse imposer son avis au Préfet, sans discussion possible (la loi prévoit par exemple une possibilité de recours du Préfet en cas d’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, lorsqu’il a valeur d’avis conforme. Un tel mécanisme n’a pas été prévu pour les avis des opérateurs radars).
En définitive, bien que l’arrêté du 26 août 2011 prévoie une possibilité d’évolution de la réglementation concernant les règles de distances, le nouveau cadre juridique paraît difficilement compatible avec les principes essentiels du droit administratif.
Une clarification juridique est donc vivement recommandée. Elle pourra intervenir spontanément ou à la suite d’un recours (direct ou par la voie de l’exception d’illégalité).
Une information parue récemment fait état d’une proposition de recours formée par la branche éolienne du Syndicat des énergies renouvelables (FEE) lors de sa prochaine Assemblée Générale du 5 octobre 2011. A suivre.



