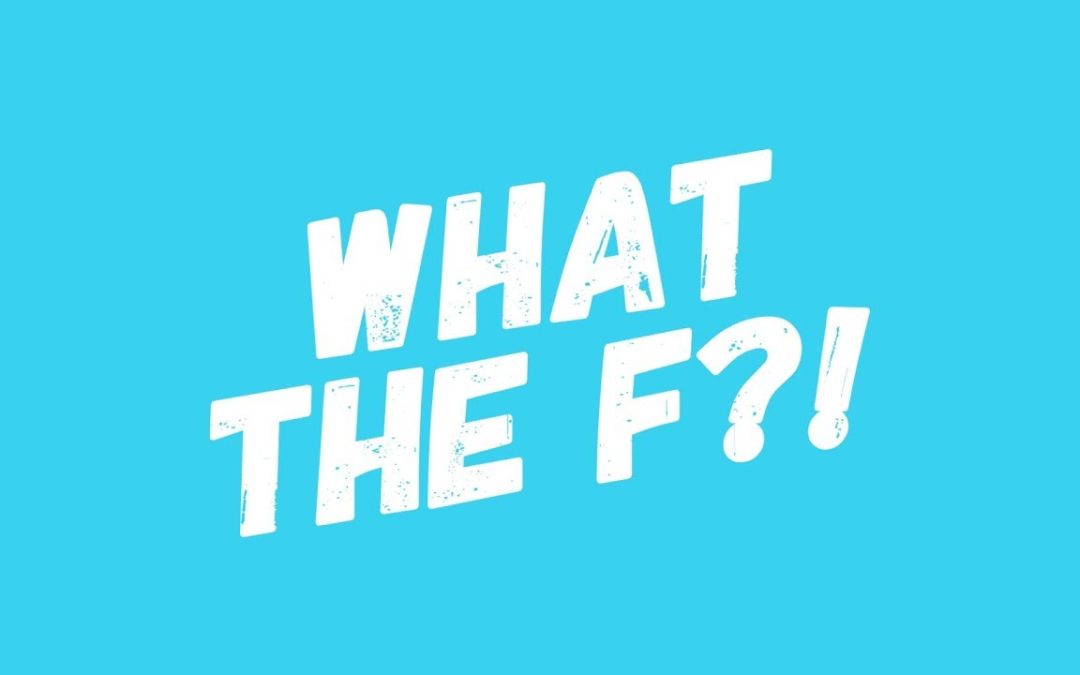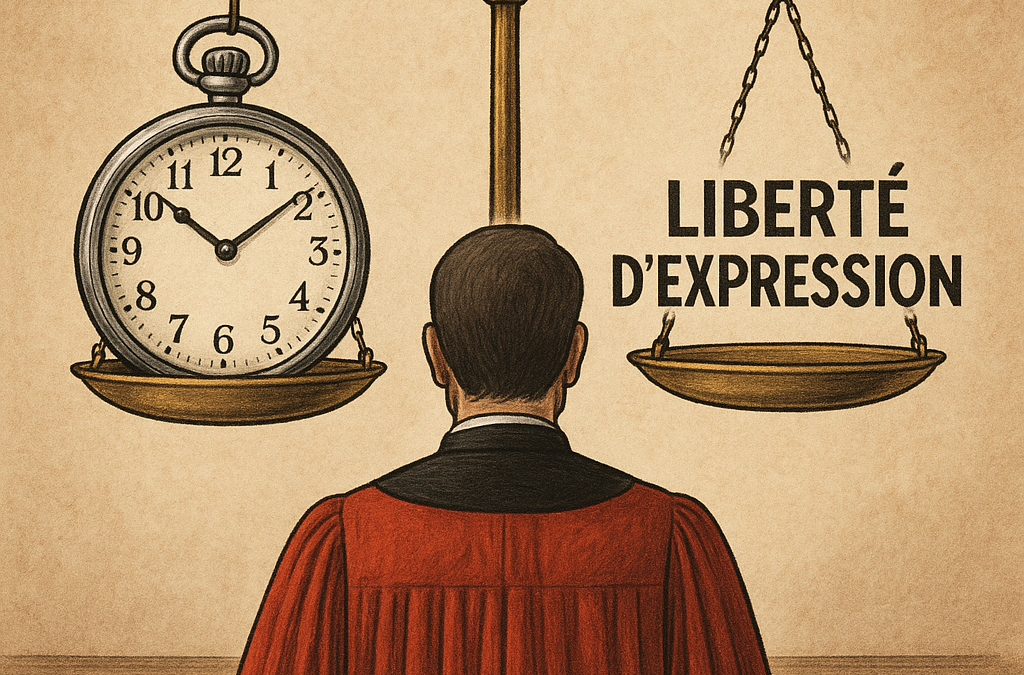Dans un intéressant et important arrêt du 26 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient d’enrichir une jurisprudence déjà complexe et nourrie s’agissant de la coordination des législations « ICPE » et « Déchets ». Il implique que le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE puisse être tenu à sa dépollution sur le fondement de la loi « Déchets ». Les effets dominos de cette décision risquent d’être nombreux.
Dans un intéressant et important arrêt du 26 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient d’enrichir une jurisprudence déjà complexe et nourrie s’agissant de la coordination des législations « ICPE » et « Déchets ». Il implique que le propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE puisse être tenu à sa dépollution sur le fondement de la loi « Déchets ». Les effets dominos de cette décision risquent d’être nombreux.
Plus classiquement, cet arrêt permet de préciser la différence entre les notions de ‘propriétaire’ et de ‘détenteur’, au regard de l’obligation d’élimination des déchets. Le propriétaire ayant fait preuve de négligence à l’égard d’abandon de déchets sur son terrain, est responsable de leur élimination (CE, 26 juillet 2011, Commune du PALAIS-SUR-VIENNE, req. n° 328.651).
L’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2011, Commune du PALAIS-SUR-VIENNE, comporte un certain nombre de points tout à fait intéressants en matière de droit des déchets et des ICPE.
1 – Les législations ICPE et Déchets peuvent s’appliquer successivement (voir concurremment) sur un même site
L’arrêt du Conseil d’État n’est pas très explicite sur ce point, pourtant essentiel, puisqu’il n’aborde pas du tout la question de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cependant, de manière indirecte mais nécessaire, on peut présumer que le site objet du litige (et plus spécifiquement d’une injonction d’élimination de déchets adressée par le maire du PALAIS-SUR-VIENNE à la société WATTELEZ) avait précédemment accueilli une installation relevant de la législation des ICPE (« usine de régénération de caoutchouc »).
La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX avait, quant à elle, jugé dans son arrêt du 6 avril 2009 (08BX00315) que : « ces pneumatiques sont devenus des déchets à la suite de leur abandon », ce que semble confirmer le Conseil d’État dans son arrêt du 26 juillet 2011.
En effet, il ressort de l’historique du dossier que la société WATTELEZ exploitait initialement une usine de régénération de caoutchouc, et qu’elle a vendu son fonds de commerce, ainsi que son stock de marchandises et de matière première, à une société EURECA, en 1989. Cette dernière société ayant été mise en liquidation en 1991, elle a cessé son activité et laissé sur le terrain, restant la propriété de la société WATTELEZ et des consorts WATTELEZ, plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés.
C’est le dernier exploitant qui est redevable des obligations de remise en état au titre de la législation des ICPE. Or, en l’espèce, le dernier exploitant (société EURECA) avait été mis en liquidation il y a près de 20 ans, de sorte que le site était « orphelin » sur le fondement de la législation ICPE.
Cette circonstance peut expliquer pourquoi le Conseil d’État valide le basculement de la législation des ICPE vers celle des Déchets. Une fois de plus, on y décèle une application pragmatique du droit.
La circonstance que les pneumatiques soient restés sur le site pendant de très nombreuses années à la suite de cette cessation d’activité permet, dans cette espèce, de faire application de la législation des déchets au lieu et place de celle des ICPE.
Une autre circonstance permet de justifier l’application de la loi « Déchets » (articles L. 541-1 et s. du Code de l’environnement) : ce n’est pas le sous-sol qui est pollué mais uniquement le « sur-sol », encombré par des matériaux (qualifiés de déchets).
En effet, seuls les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente sont exclus du champ d’application de la directive Cadre Déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 (afin de neutraliser les effets de l’arrêt Van de Walle de la CJCE du 7 septembre 2004 qui disait le contraire). A contrario, la directive Déchet n’écarte pas de son champ d’application les autres résidus d’exploitation d’ICPE, tels que les cuves, les matériaux stockés sur le sol etc…
Dès lors qu’un déchet est une substance dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (article 3 de la Directive 2008/98/CE), des pneumatiques abandonnés sur un terrain répondent à la définition de déchet, quand bien même ils résultent de l’activité d’une ICPE.
C’est peut-être là l’intérêt majeur de cet arrêt du Conseil d’État, Commune du PALAIS-SUR-VIENNE, qui valide une possibilité d’appliquer successivement (ou concurremment) les législations ICPE et Déchets sur un même site, en cas de disparition de la personne morale tenue aux obligations de remise en état au titre de la législation des ICPE.
De cette façon, l’autorité administrative conserve la possibilité d’obliger le « détenteur » des déchets provenant d’une ex ICPE (à l’exception des terres polluées) à en assurer l’élimination.
Cette décision valide en quelque sorte le passage de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE à celle du gardien des déchets. Il est cependant regrettable que le Conseil d’état n’ait abordé cette question que de manière indirecte, tant la question de l’indépendance des polices administratives est importante en droit public.

2 – Un maire peut faire usage de ses pouvoirs en matière d’élimination de déchets pour obtenir la dépollution d’un terrain ayant accueilli une ICPE
Le Conseil d’État valide plus classiquement la décision prise par le maire de la Commune du PALAIS-SUR-VIENNE mettant en demeure la société WATTELEZ et les consorts WATTELEZ d’assurer l’élimination des déchets se trouvant sur leur propriété, faute de quoi ils seraient éliminés d’office à leurs frais.
La question de l’autorité compétente en matière de droit des déchets a longuement été débattue. Aux termes de la jurisprudence la plus récente (article L.541-3 C. Env et CE, 11 janvier 2007, Barbazanges Tri Ouest, 287674), le maire est bien compétent pour exercer les pouvoirs liés à la police des déchets. Le Préfet est, quant à lui, compétent seulement en cas de carence du maire.
Tel n’est pas le cas en matière de législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : dans ce cas, c’est le Préfet qui est seul compétent.
En l’espèce, dès lors que l’on admet que des résidus d’activité d’une ICPE (pneumatiques) peuvent devenir des déchets, le Maire est également compétent.
Il demeure à trancher la question de savoir si les deux pouvoirs respectifs du préfet (police des ICPE) et du maire (police des déchets) ne peuvent pas s’appliquer concurremment ?
En effet, on sait que le pouvoir de police du préfet s’exerce sur l’installation 30 ans après la cessation régulière d’activité (L. 152-1 C. Env), peu importe que l’installation ait cessé de fonctionner (CE, 11 avr. 1986, no 62 234, Min. de l’environnement c/ Sté des produits chimiques Ugine-Kuhlman) ou que l’installation ait fonctionné sans autorisation (CAA Paris, 5 nov. 1991, no 90PA00331, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de l’environnement c/ Sté Saint-Yves).
3 – Différence entre un ‘propriétaire’ et un ‘détenteur’ de déchets
Le Code de l’Environnement rend responsable de l’élimination des déchets tout producteur ou détenteur de ces déchets.
L’administration a pu assimiler le propriétaire du terrain au détenteur du déchet qui s’y trouve, de sorte que c’est le propriétaire du terrain sur lequel sont entreposés les déchets qui est tenu pour responsable de leur élimination.
La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 6 avril 2009, avait adopté une jurisprudence plus étroite en jugeant que la seule qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel étaient entreposés des déchets, « en l’absence de tout acte d’appropriation portant sur ceux-ci », ne pouvait suffire pour conférer la qualité de détenteur au sens du Code de l’Environnement (article L.541-2) et, en tant que tel, en tant que responsable de l’élimination. En gros, le propriétaire du terrain n’est pas détenteur des déchets s’il n’en a pas accepté la garde (dépôt sauvage par exemple).
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour sur ce point en jugeant, sous forme de principe, que le propriétaire d’un terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut : « en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du Code de l’Environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandon sur son terrain ».
En d’autres termes, le Conseil d’État distingue la qualité de propriétaire et celle de détenteur :
– Si un détenteur des déchets est connu, c’est à lui d’assumer l’obligation d’élimination des déchets. Tel serait le cas si le terrain était, par exemple, loué par un tiers qui soit à l’origine de l’entreposage de déchets sur ce terrain et que la personne morale continue d’exister (mais, dans ce cas, cette personne morale serait le dernier exploitant de l’ICPE et ce serait donc au préfet d’agir…) ;
– S’il n’existe plus aucun détenteur connu des déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés les déchets peut être regardé comme leur détenteur dans certaines circonstances : Tel est le cas du propriétaire qui a fait preuve de négligence à l’égard d’abandon de déchets sur son terrain. Dans ce cas, il peut être considéré comme leur détenteur.
En effet, en l’espèce, on constate que la société WATTELEZ et les consorts WATTELEZ, propriétaires des terrains concernés, étaient originellement les exploitants de l’usine de régénération de caoutchouc. On peut considérer que cette circonstance a joué dans l’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2011, dans la mesure où la société WATTELEZ n’est pas un propriétaire « innocent » et sans lien avec l’origine de la situation.
4. Conclusion
En définitive, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX et renvoie l’affaire devant la même Cour afin d’être tranchée une nouvelle fois au motif que les requérants, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel ont été entreposés les pneumatiques, peuvent bien être tenus de l’obligation d’élimination de ces déchets dès lors qu’ils ont fait preuve de négligence à l’égard de leur abandon.
L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX ainsi que l’arrêté initial du maire de la commune de PALAIS-SUR-VIENNE sont, en revanche, confirmés s’agissant de la possibilité offerte à un maire de s’appuyer sur la législation des déchets pour assurer la dépollution d’un terrain ayant initialement accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement.
Là encore, c’est ce point de droit qui risque de soulever le plus d’interrogations juridiques :
– les législations ICPE et Déchets peuvent elles s’appliquer concurremment ?
– à partir de combien d’années un ex-site ICPE devenu « orphelin » en raison de la disparition du dernier exploitant peut-il être soumis à la législation des Déchets ?
– le pouvoir offert à l’autorité compétente en matière de déchets (le maire) peut-il être exercé en cas de stockage de déchets en sous-sol sans que cela ait entraîné une pollution objective ? (cuve d’hydrocarbures restée intègre par ex)
– dans quelles circonstances un propriétaire peut-il être considéré comme ayant fait preuve de « négligence » à l’égard d’abandon de déchets sur son terrain ?
Dans ce dernier cas, on pense immédiatement aux nombreuses décharges sauvages, parfois exploitées sur des terrains municipaux, au vu et au su de la collectivité publique pendant plusieurs décennies.
Le maire devra-t-il alors se prescrire à lui-même, sur le fondement de la législation des Déchets, l’obligation d’assurer l’élimination des matériaux enfouis (abandonnés et donc qualifiables de déchets), aux frais de la commune (et donc du contribuable) ? En cas d’inertie, un administré ou une association pourront-ils obtenir du juge qu’il fasse injonction à un Maire de faire usage de ces pouvoirs de police contre sa propre commune ?
Les effets dominos (ou boomerang ou encore pervers selon les points de vue) de cet arrêt du Conseil d’état risquent d’être nombreux.
Carl ENCKELL – CE, 26 juillet 2011, Cne de Palais-Sur-Vienne.pdf